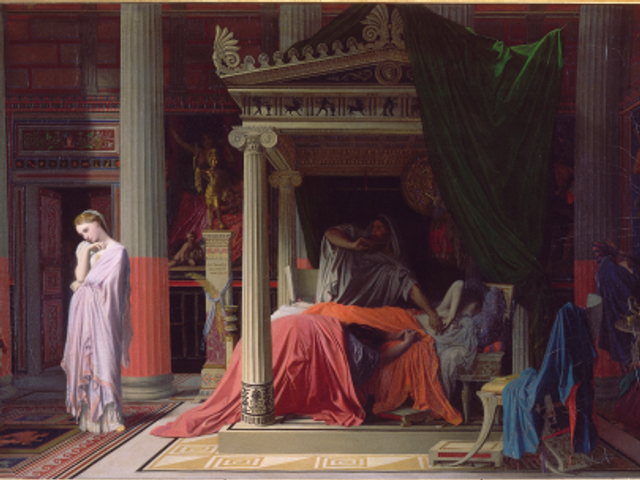C’était il y a tellement longtemps que je ne me souviens même plus de la première fois où j’ai découvert le portrait de Mademoiselle Caroline Rivière. Je l’ai vu petite fille, puis jeune fille, puis adulte. Ce qui m’a d’abord impressionnée, c’est la plasticité des lignes, des formes et des matières ; et tout particulièrement cette chose qui ne cesse de m’éblouir : cette façon dont Jean-Auguste-Dominique Ingres joue de sa relation à des matières différentes – la fourrure, la soie, la dentelle – à partir d’une seule couleur – ou d’une non-couleur, je ne sais pas comment la qualifier –, le blanc. C’est formidable ! C’est stupéfiant ! Cette symphonie de blanc m’a tout de suite séduite, avant même que je sache qui était Jean-Auguste-Dominique Ingres et qui était Caroline Rivière. De plus, il y a l’étroitesse des épaules – ce qui n’est pas physiquement possible –, ses bras très – trop ? – longs se terminant par cette paire de gants, lesquels sont presque des gants de boxe.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Mademoiselle Caroline Rivière, 1805, huile sur toile, musée du Louvre, Paris.
Photo RMN-Grand Palais/René-Gabriel Ojéda
L'essence du modèle
On assiste ici à quelque chose d’incroyable : ce passage de l’enfance à l’âge adulte de cette jeune fille de 13 ans que le peintre a su transcrire à partir de la très grande fragilité et de la très grande force du modèle, en particulier la présence de ces gants jaunes qui la protègent, mais sont aussi comme un défi qu’elle envoie directement au monde. On saisit, peut-être pour la première fois, tous les enjeux de ce passage de la vie humaine que sont la découverte et l’affirmation de soi, un sujet qui n’était pas si courant au tout début du XIXe siècle. Caroline Rivière est là, dans son portrait, comme une personne ; et elle a conscience d’être cette personne. Ce tableau, ce sont la transformation de soi et l’affirmation d’un devenir. Elle ne cherche pas à y être autre chose que ce qu’elle est. Elle me dit : « Sois fidèle à ce dont tu as envie ! » Le jour où j’ai appris que Caroline Rivière était morte peu après avoir posé pour son portrait, j’en ai été triste, et j’en suis encore triste. Elle n’était pas appelée à être simplement la fille de ses parents ; elle était appelée à être quelque chose de plus qu’elle laisse transparaître à travers la certitude de sa pose, son attitude, ce regard que Jean-Auguste-Dominique Ingres a magnifiquement saisis. Pour cela, il fait preuve, d’une part, d’une très grande liberté vis-à-vis de son art propre en mettant à bas le respect de l’anatomie humaine, en passant de la norme au bizarre ; de l’autre, il se place dans la continuité des toiles italiennes du quattrocento, de Raphaël et d’avant Raphaël, tout en les amenant vers une autre dimension, vers la modernité : Caroline Rivière est la représentation d’une adolescente seule, sans ses parents ni aucune autre raison – thématique ou illustrative – sinon elle-même.
Dans ce portrait, Jean-Auguste- Dominique Ingres est respectueux des codes picturaux dont il a hérité, et s’en libère tout à la fois en inventant un nouveau code de représentation et un nouveau genre pour la peinture. Lui qui voulait être peintre d’histoire, il y devient un peintre de portrait. Et il saisit non seulement l’apparence du modèle, mais sa profondeur et sa psychologie mêmes. Représenter une personne, ce n’est pas être fidèle à ses traits, ce n’est pas être un parangon d’exactitude, mais c’est révéler une vérité intérieure. Et cela me touche terriblement. Au-delà, c’est la mise en œuvre de la créativité d’un artiste. On retrouve cela dans l’œuvre des tout premiers photographes, à l’instar des daguerréotypes des années 1840-1850 de Jean-Baptiste Sabatier-Blot conservés au musée d’Orsay [à Paris], ou les portraits de Nadar qui a lui aussi beaucoup regardé Jean-Auguste-Dominique Ingres. Il n’y a presque jamais de superposition entre une chose et sa représentation, en peinture comme en photographie.
Un lien enthousiaste au musée
Parmi les œuvres que j’ai très tôt appréciées au Louvre, il y a également le magnifique torse de Milet, trouvé dans l’ancienne cité grecque dont il a pris le nom, près d’Éphèse (vers la côte sud-ouest de l’actuelle Turquie). Il est l’emblème parfait du passage entre la Grèce préclassique et la Grèce classique. Il a d’ailleurs été donné au Louvre par Gustave et Edmond de Rothschild au même moment que le don, en 1870 et 1874, des trois tableaux de la famille Rivière. Ce torse me fascine en tant que balancement, car c’est l’inverse du portrait de Caroline Rivière, en tant qu’expression même d’un matériau, d’un volume, d’une puissance dominant le regard. Et, bien sûr, il y a Le Radeau de la Méduse, en raison de la décision prise par Théodore Géricault de l’instant de la représentation : non pas celui où ils vont être sauvés, mais celui où le bateau ne les voit pas et où ils sont obligés de l’appeler, de le faire revenir, afin d’être secourus. C’est le moment du désespoir le plus noir qu’exprime cette diagonale de composition d’une force et d’un souffle absolus, et qui culmine avec cet homme en contre-jour agitant vers l’horizon sa chemise rouge comme un drapeau.
Ma première visite au Louvre, avec mes grands-parents, doit dater de l’année de mes 5 ans. Ensuite, j’y suis allée presque tous les mois avec ma professeure d’histoire, madame Driancourt, laquelle adorait les musées. Elle offrait à ses élèves une liberté de penser. Elle ne nous disait pas : « on va au Louvre, voilà ce qu’il faut regarder », mais « choisissez ce que vous voulez regarder »... Comme j’étais déjà assez imaginative, c’était exactement ce qu’il fallait me dire. Le musée est dès lors devenu un terrain de jeu. C’est ce que je dis toujours : « Profitez du Louvre ! Profitez des musées ! À vous ! »