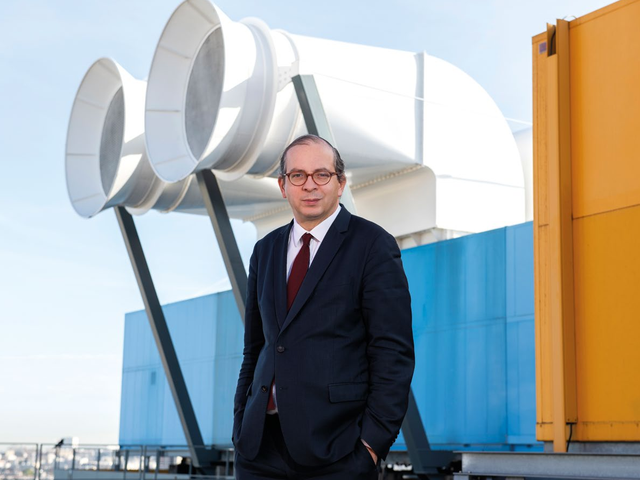La réouverture du Grand Palais se fait en grande pompe avec « Grand Palais d’été », un nouveau programme proposant à la fois, en partenariat avec le Centre Pompidou, des rencontres et performances dans le cadre de « Fun Palace », des expositions – « Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hultén », la collection d’Art brut de Bruno Decharme –, seize tapisseries contemporaines dessinées par des artistes danois, l’exposition « Euphoria. Art is in the air », mais aussi du spectacle vivant, des concerts, des événements festifs plus grand public... Ce mélange des genres laisse-t-il augurer de votre programmation future ?
Toute mon action, depuis que j’ai commencé, a été d’ouvrir à un public le plus large possible. J’ai toujours pensé qu’il ne nous appartient pas de décider quel est le bon goût, mais plutôt de proposer l’ensemble de ces possibilités : « Fun Palace » et des grandes expositions artistiques avec le Centre Pompidou, mais aussi des installations majestueuses à l’échelle du Grand Palais, à l’instar de Nosso Barco Tambor Terra conçue par l’artiste brésilien Ernesto Neto. L’accès à une partie de ces nouveaux espaces de 7 000 m², dans cet endroit sublime, est désormais gratuit. Ces expositions, ces rencontres, vont procurer une sorte de joie de vivre, d’être dans le bâtiment. C’est une volonté de redonner vie à ce lieu, grâce au mécénat de Chanel qui a permis l’opération du « Grand Palais d’été ». Nous avons commencé avec « Vertige » de Rachid Ouramdane, Christophe Chassol et Nathan Paulin, un spectacle que l’on ne peut pas imaginer ailleurs. Tous ceux qui y ont assisté en ont gardé un souvenir inouï. Avec « Le grand palais de ma mère » de Mohamed El Khatib, c’est encore autre chose. C’est pour cette raison que nous avons compartimenté le Grand Palais en trois zones. Nous le ferons à nouveau l’an prochain, avec une partie spectacle et une grande exposition payante, mais plus entertainment.

« Vertige », spectacle de Rachid Ouramdane, Christophe Chassol et Nathan Paulin, juin 2025. Photo : Quentin Chevrier
À moyen terme, quelle est votre vision pour ce lieu historique au cœur de Paris ?
Ma vision est d’abord celle du partenariat. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec le Centre Pompidou, c’est une richesse insensée. Comme de travailler avec la Manufacture nationale ou Chaillot, et ce sera le cas aussi avec l’Opéra de Paris, l’Opéra-comique… Le Grand Palais, c’est la réunion des grands talents, des grandes institutions, et des plus petites installations. En ce moment, nous travaillons avec la Maison de la Danse de Lyon. Le Grand Palais est un palais national, il appartient à tout le monde. C’est un palais qui n’a pas de collection. Nous n’avons que des murs, avec certes un volume phénoménal. Nous avons un patrimoine bâtimentaire mais rien à vendre de plus. C’est l’accumulation de ces envies d’autres artistes, de Pascal Dusapin, grand compositeur de musique, qui est venu ici, à Claire Tabouret ou Eva Jospin, deux artistes contemporaines qui vont y travailler en novembre. Demain, il y aura Matisse, Cezanne… Alors effectivement, de l’extérieur, on pourrait se dire, c’est n’importe quoi. Or, c’est précisément cet éclectisme de bon aloi que nous revendiquons. Ne pas être directif dans l’envie que pourrait avoir un public de découvrir le Grand Palais. Si vous ne voulez pas aller voir « Euphoria. Art is in the air », vous pouvez découvrir « Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hultén ». Mais vous pouvez aussi voir les deux. Niki de Saint Phalle a réalisé des œuvres gonflables. J’ai toujours défendu cette perméabilité. Richard Shusterman, un philosophe américain que j’aime beaucoup, a dit : « Il faut arrêter de séparer l’art populaire de l’art noble ». Il y a des choses ridicules dans l’art noble, et il y a des choses sublimes dans l’art populaire. Et c’est le croisement des deux qui crée quelque chose de très populaire. On peut être populaire en étant un grand intellectuel. Ce n’est pas si simple d’entrer dans le Grand Palais. Le bâtiment est extrêmement imposant. Si vous n’avez pas l’habitude d’y aller, si vos parents ne vous y ont pas emmenés quand vous étiez petits, ou dans des lieux culturels similaires, vous n’y allez pas. Par conséquent, il faut inciter les gens à y venir. Ernesto Neto est un artisan de la fête. Son œuvre, c’est la rencontre. « Fun Palace », c’est aussi les assemblées, on échange, on discute… C’est la même chose, le même esprit. Les gens vont se mélanger, se rencontrer. Le Grand Palais va être tout ça.
Fort de votre expérience à la Grande Halle de la Villette, vous ambitionnez d’élargir le public mais aussi de lui donner un coup de jeune, avec une programmation nocturne, du clubbing…
Oui, c’est une volonté affirmée. Dans notre esprit, ce sont des soirées qui ne finissent pas. Ça commence par un spectacle et continue sous une autre forme. Ce qui est très beau au Grand Palais, pour parler des opérations nocturnes, c’est que, tout à coup, la nuit tombe, mais on ne la voit pas arriver. Vous commencez, il fait jour – surtout en été, évidemment ; vous êtes sous le ciel bleu. Le spectacle a lieu et quand il est fini, il fait nuit. Et ça, c’est complètement magique. Lorsque nous avons ouvert l’exposition « Chiharu Shiota » jusqu’à minuit, « Dolce & Gabbana » jusqu’à 2 heures du matin, la patinoire jusqu’à 5 heures du matin, nous avons accueilli un public nocturne, beaucoup plus jeune, qui sort la nuit. Parce que nous sommes à Paris et sur les Champs-Élysées. Nous ne l’avions pas prévu au début. Mais compte tenu de l’affluence, nous avons élargi les horaires. Les derniers visiteurs rentraient dans l’exposition avec un ticket d’entrée à 2 heures du matin ! Et nous ouvrions à 8 heures, parce qu’a contrario, vous avez aussi des gens qui se lèvent tôt, ont des petits enfants... Pour nous, le Grand Palais doit être extrêmement malléable. Nous l’avons toujours dit : c’est un palais des fêtes. Antoine Vitez, c’était le théâtre élitaire pour tous. Nous devons avoir cette exigence. Le matin ou la nuit, le public visite la même exposition, mais pas dans le même état d’esprit. Et ça, c’est très réjouissant.
Vous citez pour modèle le Théâtre national populaire (TNP) d’Antoine Vitez. Vous venez précisément du spectacle vivant, des Folies de Maubeuge dans les années 1990 à la Maison des Arts de Créteil. Le sens du spectacle est dans votre ADN culturel…
Absolument. C’est vraiment l’idée de prolonger cet esprit, cette philosophie. Ces grands rêves de démocratisation de la culture partent aussi des lieux. Pour cela, il faut pouvoir y avoir accès, créer un désir d’y venir. Jean Vilar disait : « Les enfants, c’est la clé du trésor ». Nous avons signé une convention avec les trois académies de Paris, Créteil et Versailles. Les professeurs visitent les expositions avec leurs élèves. Ensuite, les enfants repartent avec une invitation pour deux pour revenir le week-end. Ils deviennent les guides de leurs parents. Cela n’a l’air de rien, mais souvent, ils amènent des parents qui n’y sont jamais allés. L’école est vraiment l’endroit absolu, à nous de faire en sorte que les enfants puissent venir au Grand Palais et y revenir, accompagnés. Fidéliser est essentiel. Nous avons lancé un abonnement très simple et un pass, qui rencontrent beaucoup de succès. Nous souhaitons que le Grand Palais devienne une fête, qu’on ait envie d’y aller, que ça fasse partie de votre vie.

L'installation monumentale Nosso Barco Tambor Terra de l'artiste brésilien Ernesto Neto dans la nef du Grand Palais. © GrandPalaisRmn 2025, Didier Plowy
Vous vous inscrivez dans une certaine idée de la culture héritée des années Lang, la décentralisation, « l’élitisme pour tous »…
J’ai une admiration sans borne pour Jack Lang. Les années Lang, j’en suis issu. J’ai vécu cette explosion, le doublement du budget du ministère de la Culture. Il suffisait d’être jeune, d’avoir des idées – même en venant de Maubeuge –, nous étions soutenus. Il y a une grande humilité, on ne commence pas à se dire : on est en train d’inventer des trucs. D’autres avant nous ont fait des choses encore plus grandes. Nous essayons de nous en inspirer, de le transposer dans l’époque qui est la nôtre, où tout coûte beaucoup plus cher, est plus compliqué. C’est un état d’esprit d’invention, de liberté pour les artistes, mais aussi pour le public. Par exemple, lorsqu’on propose d’assister au spectacle « Vertige », assis par terre dans la nef. Cela n’arrive plus d’être assis sur des tatamis, de pouvoir être allongé avec sa copine ou son copain. C’est très important que chacun se sente libre en fonction de ses convictions, de son mode de vie. Et c’est permis au Grand Palais pour une raison extrêmement simple : c’est immense. Les gens trouvent leur coin, leur petit endroit à eux. Ils sont sur leurs réseaux sociaux, s’installent pour lire un livre. Il faut des lieux comme le nôtre. C’est aussi ce que nous avons fait avec les quatre jeunes artistes brésiliens de l’exposition de peintures « Horizontes » présentés dans le cadre de la saison Brésil-France 2025. Le public vient voir l’installation spectaculaire d’Ernesto Neto et les découvre en montant l’escalier. Nous avons vu des visiteurs qui n’allaient jamais au musée extrêmement émus devant ces œuvres magnifiques. C’est exactement ce que nous cherchons à créer.
Quels sont vos projets après cette première programmation estivale, destinée à devenir un rendez-vous annuel ?
Nous aimerions inviter la très dynamique scène marseillaise. Cette année, il y a le Brésil, avec un grand bal brésilien Rio-Paris gratuit organisé dans la nef le 5 juillet. Je crois que si, chaque année, une grande ville, française ou étrangère, dans toute sa diversité, est invitée au Grand Palais, cela pourrait être assez amusant. Le Grand Palais est hors limite.
Le Palais de la découverte voisin devait être inauguré en juin avec plusieurs événements qui ont été annulés. L’Élysée a débarqué le 12 juin, à l’issue du Conseil des ministres, Bruno Maquart, président d’Universcience, l’établissement public qui chapeaute depuis 2009 la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte, sur fond de dissensions avec la ministre de la Culture. Le musée scientifique redoute une mainmise du Grand Palais sur l’ensemble des espaces du Palais d’Antin, qui l’abrite depuis 1937. La Rue de Valois a ouvert la porte à un déménagement à la Cité des sciences à la Villette. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche s’est ensuite déclaré favorable au maintien dans l’enceinte du Grand Palais. Quelle est votre position ?
Cela n’est pas de mon ressort. La décision appartient au président de la République et à la ministre de la Culture. Je me suis exprimé pour l’aspect bâtimentaire. La réouverture a été fixée en trois phases depuis le début : les Jeux olympiques, l’arrivée du Centre Pompidou, enfin le Palais d’Antin, qui doit ouvrir en décembre. Pour la réouverture du Grand Palais, le Palais d’Antin n’était pas encore équipé. L’architecte en chef, François Chatillon, a écrit à la ministre pour expliquer qu’il était hors de question d’utiliser ces espaces. Ce n’est pas ma volonté. Nous avons coproduit « Transparence », la première exposition destinée aux enfants, avec les équipes d’Universcience. Il me semble néanmoins normal de s’interroger, quand on rouvre un tel outil, sur le mode de fonctionnement du Grand Palais. Le débat est ouvert. Comment peut-on redéfinir la place de la science à Paris ? La Cité des Sciences représente deux fois le Grand Palais en termes de surface, c’est un endroit que j’adore, avec des équipes fantastiques. Certains veulent faire croire que, tout d’un coup, il n’y a plus de sciences à Paris, pour des raisons qui d’ailleurs n’ont rien à voir avec les sciences. Pour eux, Paris, c’est trois arrondissements. La Cité des sciences est trop loin. Il faut peut-être changer, être un peu plus moderne.