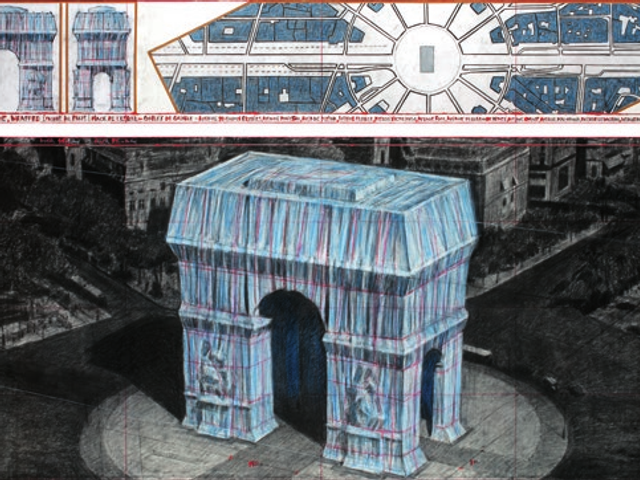On entre par le passage du Cheval-Blanc depuis la place de la Bastille. Dans le calme de ce passage parisien, on oublie aussitôt le vacarme de la circulation. C’est là que Michael Woolworth a installé son atelier en 2005, un lieu qu’occupait avant lui Franck Bordas, petit- fils de Fernand Mourlot, l’imprimeur de Pablo Picasso. Comme les trésors nationaux vivants, au Japon, Michael Woolworth a reçu le titre de Maître d’art en 2011 ; il a été promu chevalier des Arts et des Lettres la même année, et son entreprise a obtenu le label « Patrimoine vivant » en 2012. Sous la grande verrière, on entend de la musique en permanence. Les artistes sont chez eux, dans un mélange de traditions ancestrales et de contemporanéité extrême. Entre les bibliothèques et une table d’architecte, quatre presses les attendent. Il se pratique ici la lithographie, le bois gravé, la gravure sur cuivre, la linogravure, le monotype... Sur la cour de Février donne une galerie où sont exposées des œuvres sorties de l’atelier. Régulièrement, des événements ont lieu, lectures ou performances, qui font entrer des visiteurs dans cet univers presque familial.
Vous venez de créer Paris Danube Print Salon. Comment ce nouveau Salon s’inscrit-il dans le paysage de l’édition d’art ?
Je voulais un Salon qui soigne le monde dans lequel je vis, un monde plus intime et secret que celui des grandes foires. Avec les artistes Edouard Wolton et Wernher Bouwens, également professeurs en techniques d’impression aux Beaux-Arts de Paris, j’ai voulu offrir au public la possibilité de rencontrer des éditeurs et des imprimeurs – ces « faiseurs », souvent dans l’ombre –, et d’acheter le fruit de leur travail. Le Salon s’est tenu dans un lieu insolite : l’hôtel du Danube, à Saint-Germain-des-Prés [dans le 6e arrondissement], où chaque chambre a son propre décor. Une vingtaine d’éditeurs internationaux y ont été réunis. Le but était de les mettre tous sous le même toit pendant quatre jours, pour partager, échanger et créer un véritable esprit de communauté.
À l’heure où les technologies sont omniprésentes, il semble y avoir
dans l’édition d’art une dimension particulièrement contemporaine.
Même si mes presses manuelles datent du XIXe siècle, on les tord, les subvertit, les fait presque entrer en collision avec l’univers de chaque artiste. C’est toujours le geste direct sur la matrice qui compte, peu importe la technique. Le numérique est devenu un outil supplémentaire permettant d’apporter l’image photographique ou virtuelle sur la matrice. Mais ce qui reste essentiel, c’est la main sur la plaque, la pierre, le papier.
Vos exposants venaient de différents endroits du monde. Comment situez- vous Paris sur la scène internationale de l’édition d’art ?
Historiquement, la France est un pays très puissant en matière d’impression, avec une tradition bicentenaire d’ateliers professionnels et une richesse patrimoniale unique – la Bibliothèque nationale en est un exemple, avec des trésors comme l’exposition sur les Nabis. Dans d’autres pays européens, les ateliers sont souvent associatifs, et les artistes paient un forfait pour imprimer eux-mêmes leurs œuvres. Pour ce premier Salon, nous avons eu des exposants venant de neuf pays. Paris reste un vrai repère pour l’édition d’art, attirant à la fois les grands éditeurs européens et suscitant beaucoup d’intérêt chez les Américains. La ville vibre avec ses galeries, ses musées, ses événements, et le Print Salon offre, à son échelle, un endroit intime pour échanger, partager et prendre le temps avec l’art.
Récemment, Frédéric Boyer lisait dans votre atelier Les Géorgiques de Virgile, illustrées par Blaise Drummond. Quelle place faites-vous au texte ?
Nous sommes d’abord des imprimeurs d’images. Nous faisons surtout des livres de peintres tirés en toutes petites éditions, de vingt à cinquante exemplaires. Les artistes proposent parfois des textes ou intègrent leurs propres écrits. Notre livre avec le peintre irlandais Blaise Drummond s’inscrit dans cette lignée, aux côtés de textes classiques : Les Mille et Une Nuits avec José María Sicilia, L’Histoire naturelle de Pline l’Ancien avec Marc Desgrandchamps, Théogonie de Hésiode avec Anne et Patrick Poirier, le Quichotte avec Roberto Matta. La lecture par Frédéric Boyer d’extraits de sa traduction des Géorgiques pour fêter le lancement de notre livre a été magique.
Pour créer le Paris Danube Print Salon, aviez-vous des modèles de foires ?
En 2015, j’ai cofondé les Multiple Art Days (MAD), qui rassemblaient les éditeurs comme moi, mais également l’édition rapide et légère, les multiples bon marché. Les microéditeurs étaient ravis de côtoyer les grandes galeries, et inversement. J’ai dirigé ce Salon pendant neuf ans, puis j’ai juré de ne plus en refaire... Mais avec cet hôtel, je n’ai pas pu dire non.

Lamarche-Ovize, Rosmarino Sunset (été), 2025, bois gravé et lithographie originale.
© Lamarche-Ovize. Photo Michael Woolworth
Vous êtes né à Augusta, dans le Maine. Que vous reste-t-il de l’Amérique ?
Je suis né au-dessus de la rivière Kennebec, en plein centre-ville. J’ai grandi là et aussi à Midtown, dans Manhattan. J’ai commencé mes études de géologie dans le Maine, mais à la fin de ma première année d’université, je suis venu faire un tour d’Europe. Arrivé à Paris, je n’en ai plus bougé. Aujourd’hui, je me sens un peu hybride. Mon regard américain, c’est cette fraîcheur d’esprit : ne pas avoir peur d’y aller, même si je me retrouve dans des situations compliquées, artistiquement ou financièrement. On continue, on pousse la roue. On n’est pas des déprimés ! Je retourne rarement aux États-Unis, mais j’y suis toujours très à l’aise.
Y avait-il beaucoup d’art dans votre enfance ?
Oui, des artistes et des œuvres, mais je n’étais pas du tout destiné à un avenir dans ce milieu, et je ne concevais pas ma vie ainsi. J’avais simplement l’esprit ouvert. Sous mes jeunes yeux, c’était non pas de l’art contemporain, mais de l’art américain de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Chez nous, il y avait des tableaux d’impressionnistes américains fin-de-siècle comme John Singer Sargent, Charles Frederic Remington, Childe Hassam, Charles Burchfield... Et puis il y avait des réalistes, William Harnett et Rembrandt Peale, mais surtout les trois générations de Wyeth, dont mon préféré a toujours été le patriarche, N. C. Wyeth. Son fils, Andrew, a fait partie de mon enfance ; il était constamment avec nous dans le Maine. Je le regardais travailler, et il nous racontait, à mes sœurs et moi, des contes fantastiques pour nous faire peur.
En arrivant à Paris, votre rencontre avec Franck Bordas a été déterminante.
Comme beaucoup de jeunes de 18 ans, je cherchais un « job » pendant les vacances d’été. J’ai d’abord tenté serveur dans les bars américains, aux Halles – Joe Allen est aujourd’hui le dernier. Un échec cuisant ! Finalement, un peintre français m’a dit qu’un jeune homme de mon âge venait d’ouvrir un atelier dans le Marais et qu’il était débordé. Il préparait une exposition avec Guy de Rougemont et Maurice Matieu pour Le Dessin, la galerie de Claire Burrus [ouverte en 1974, rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris]. J’ai commencé à travailler en « palefrenier » de l’atelier, dans cette ambiance très française. J’étais tombé sans le savoir dans la royauté de l’impression d’art, car Franck était le petit-fils de Fernand Mourlot et le fils de l’éditeur Pierre Bordas. Depuis, je ne suis jamais reparti.
Que vous a-t-il appris ?
Il m’a tout appris ! Je n’ai pas changé de manière de faire depuis cette époque. Nous étions comme des « Sioux » sur des presses à bras, avec des tirages très limités. Tout ce que je suis aujourd’hui vient de là. Je travaille toujours dans un atelier manuel sur les mêmes principes : inviter les artistes, faire des recherches, les éditer, les vendre. Et pour tenir économiquement, nous prenons aussi des commandes de galeries, de musées, de sociétés ou d’artistes qui s’autoéditent. Il a fallu cinq ou six ans pour maîtriser la technique et mener un projet avec confiance. Mais le plus important, c’est écouter, dialoguer, collaborer, accompagner un artiste, le mener à bon port. Ce sont des choses qui ne s’apprennent pas ; il faut les vivre. À un moment, Fernand Mourlot, sortant de sa retraite à 87 ans, est venu refaire de la lithographie avec nous et nous a amené Jean Dubuffet, lequel a fait ses Exercices lithographiques dans notre atelier. J’avais atteint le summum à juste 21 ans ! Plus tard, Franck a voulu se tourner vers la mécanique ; quant à moi, je suis resté fidèle au travail manuel qui me parlait le plus. J’ai poursuivi la route avec plusieurs artistes que nous avions beaucoup fréquentés ensemble : Daniel Pommereulle, Roberto Matta, le surréaliste cubain Jorge Camacho ou encore Pierre Mabille.
Comment était le Paris des années 1980 ?
C’était fabuleux. Arriver en jeune Américain provoquait des étincelles dans les yeux. J’ai fait des rencontres exceptionnelles : écrivains, poètes, musiciens... Il y avait la figuration narrative et la fin du surréalisme. Mais les artistes étaient différents de ceux d’aujourd’hui, beaucoup plus cultivés et plus vifs politiquement. Ils suivaient les crises de société, allaient manifester pour défendre leurs causes. La gauche n’était pas encore au pouvoir.
Les artistes avec lesquels vous travaillez sont très divers et de différentes générations. Certains reviennent régulièrement comme une famille. Comment les choisissez-vous ?
Il y a mille façons de créer des rencontres. Ceux que j’invite pour les éditer sont des artistes dont j’ai envie d’avoir une œuvre chez moi. J’ai toujours fait des choix très éclectiques, abstraits, conceptuels, hyperréalistes... un peu comme la musique que l’on écoute toute la journée dans l’atelier. C’est essentiel pour moi de faire venir une nouvelle garde : Mélanie Delattre-Vogt, Abdelkader Benchamma, Maude Maris, Massinissa Selmani, Claire Chesnier, Johann Rivat ou même le bédéiste Brecht Evens. Pour qu’un atelier comme celui-ci existe, il faut des jeunes. On vit ensemble, on discute, on se conseille les artistes, les expositions, les critiques ou les livres. Mais il y a aussi les plus établis : James Siena ou Anne et Patrick Poirier, les plus punks de toute la bande. Et puis certains, entre autres Marc Desgrandchamps, Djamel Tatah et Gilgian Gelzer, font partie de notre famille.
Leur offrez-vous une carte blanche ? Ou bien viennent-ils parfois vous voir avec un projet ?
Ni l’un ni l’autre. C’est d’abord une rencontre. Lorsque l’on commence à travailler ici, l’atmosphère est très intime. Je veux choisir mes compagnons de route. Ils peuvent être hésitants au début, mais, très vite, se révèlent, pour eux comme pour moi, les raisons pour lesquelles nous avons monté ce projet. Nous construisons une œuvre année après année. Je ne veux pas de one shot. Pour faire de bonnes choses, il faut de la lenteur et du temps, surtout dans le monde d’aujourd’hui.
Que leur dites-vous le premier matin ?
En général, je cherche ceux qui n’ont jamais pratiqué ce travail. Sinon, ils risquent trop vite d’appliquer un système de fabrication – alors on les bouscule un peu. Mon rôle est de les mettre à l’aise pour qu’ils se lancent sur des matrices. Parfois, cela ne marche pas, et parfois, les premières choses qu’ils font sont les meilleures, car ils n’ont encore aucune règle en tête.
Comment se répartissent les opérations ?
J’ai trois imprimeurs à l’atelier, Paul, Léa et Gaëtan ; ils sont l’extension de mes bras. Je m’occupe surtout des discussions avec les artistes et du montage des matrices. Mes collaborateurs interviennent pour les essais de couleurs, de matières et le tirage final après le bon à tirer. Les artistes ne tournent jamais la roue ni n’encrent. Chacun son rôle. L’atelier est un espace où l’inattendu et l’imprévisible font partie du processus : superposer les couleurs, ajuster les gestes, observer la réaction du papier et de l’encre. C’est un peu comme un studio d’enregistrement où chacun improvise pour obtenir la meilleure version d’un morceau. Nous travaillons avec toute mon équipe et parfois des stagiaires – nous passons la journée ensemble, prenons le café, déjeunons, échangeons des idées – et chacun apporte son avis. C’est ce dialogue constant qui fait avancer le projet.

Marc Desgrandchamps, Les Hautes Plaines, 2025, monotype.
© Marc Desgrandchamps. Photo Michael Woolworth
Qu’est-ce qui est le plus difficile ?
Le plus difficile ? Oh, je ne sais pas, il y a tant de situations où la technique peut nous mettre en difficulté. Les grands aplats de Djamel Tatah sont souvent ardus, les impressions sur feuille d’or de Jean-Michel Othoniel également, voire l’intense précision d’un James Siena. Ce qui compte, c’est de laisser surgir l’inattendu. Chaque image naît sur place, chaque geste peut créer quelque chose de nouveau.
Dans quelle mesure les artistes qui viennent à l’atelier jouent-ils avec ces techniques ?
C’est la définition même de l’atelier, un terrain de jeu par excellence. Ils font beaucoup d’expériences avec nous, parfois très risquées. Chaque artiste a sa manière d’approcher le médium. José María Sicilia, par exemple, est un véritable penseur de l’estampe, sur le plan conceptuel, mais aussi en matière et en formats d’édition. Pendant des années, il a expérimenté ce que l’on peut appeler « l’original multiple » : on imprime une image et, dès sa sortie de presse, il intervient avec des solvants pour détruire l’impression. Nous avons écrasé des fleurs vivantes sous la presse pour qu’elles laissent leurs couleurs sur la feuille, fait courir un lézard dont nous avions trempé les pattes dans l’encre sur les pierres lithos ou utilisé de la cire d’abeille au bain-marie pour baigner des œuvres imprimées sur papier Japon, leur donnant une sorte de translucidité surprenante. Chaque expérience est une réflexion sur ce qu’est une feuille et à quoi sert une édition. Pour une exposition au musée du Louvre en 2003, nous avons même imprimé un tapis de 9 mètres sur 3 sur des carreaux de plâtre, qui a été montré dans les salles du département des antiquités orientales. Un véritable exploit !
Vous avez aussi beaucoup travaillé avec l’artiste chilien Roberto Matta, avec l’Américain Jim Dine...
Avec Roberto Matta, cela a duré plus de quinze ans, sur un seul sujet ! Nous avons réalisé trois versions de Don Quichotte, deux portfolios merveilleux et une boîte d’allumettes qui contenait une impression en accordéon de 5,50 mètres de long. C’était une rencontre extraordinaire, il était le chaos cosmique. Jim Dine a une irrévérence formidable dans sa façon de créer des éditions, et une vraie virtuosité de la main. Il aborde toujours ses thèmes obsessionnels – la figure de Pinocchio notamment – avec la fraîcheur du premier geste. C’est également ici à l’atelier que sont nées ses premières œuvres abstraites, en 2014 et 2015.
Avez-vous une méthode différente d’autres ateliers ?
Je ne sais pas si nous avons une « méthode », chacun a la sienne. Ici, nous expérimentons sans cesse, nous combinons les techniques, nous repoussons parfois leurs limites ou en inventons de nouvelles. Les formats et supports changent selon les souhaits des artistes, et nous les poussons parfois hors de leur zone de confort. L’atelier, c’est un esprit de partage, de curiosité et de disponibilité, où l’on accueille les accidents. Dans un monde standardisé, c’est un vrai lieu de résistance.
Qu’en est-il des archives de l’atelier ?
Le site Internet de l’atelier ne présente que nos éditions, mais nous en réalisons bien d’autres en commande. Je garde une épreuve de tout ce que nous faisons, parfois des étapes intermédiaires. C’est un peu comme un carnet de route de toutes ces expériences, de ces moments d’invention et de surprises qui font vivre l’atelier.
Vous dites que l’édition d’art est un prétexte. Un prétexte pour quoi ?
Je considère que je fais de l’art, pas seulement du print ; nous mettons des surfaces « sous pression ». L’édition d’art est un prétexte pour créer un dialogue avec les artistes. Tout ce que nous faisons à l’atelier – même les projets les plus fous – naît de cette envie de faire de l’art ensemble, à la main, avec patience et dans la complicité.
L’année 2025 a été une année très riche, avec de nombreuses collaborations et manifestations qui nous ont permis de partager notre travail avec un public plus large. Ainsi, plusieurs expositions ont eu lieu autour de nos collaborations : en début d’année, à l’Espace de l’art concret, à Mouans-Sartoux, et maintenant au musée de la Chasse et de la Nature, à Paris, avec le duo Lamarche-Ovize ; avec Brecht Evens à Bastia et au musée des Beaux-Arts de Cherbourg, également en Belgique à La Louvière ; au palais des Papes, à Avignon, avec Jean-Michel Othoniel. Une soirée de lancement d’un livre d’artiste entièrement réalisé en monotype par Christian Schwarzwald – une véritable folie qui brise toutes les règles ! – au palais de la Secession, à Vienne, en Autriche. Nous avons même été invités à déplacer l’atelier et les artistes au musée d’Orsay, à Paris, pendant quatre jours, et à nous installer en plein milieu de la nef, pour imprimer devant les visiteurs. Et puis nous célébrons, par une exposition, à partir du 12 décembre, les 40 ans de l’atelier. Tout ce que nous réalisons, et continuons de réaliser, est fait à la main. C’est une belle histoire de vie.