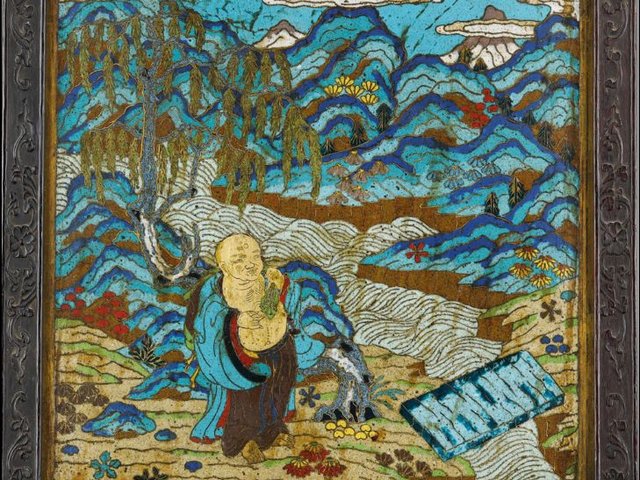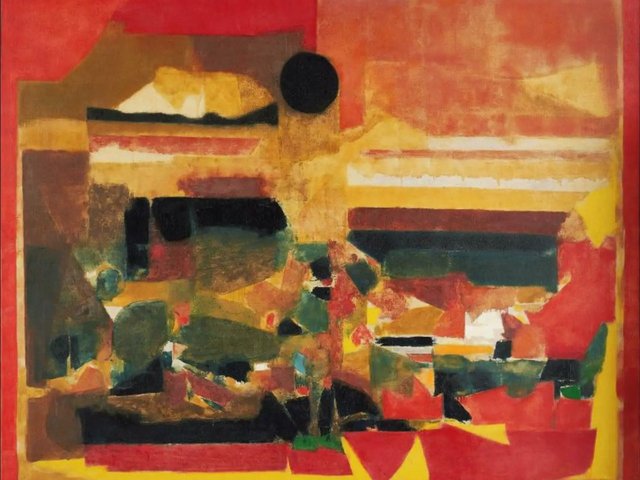L’exposition « Bronzes royaux d’Angkor, un art du divin » est le fruit d’une coopération exemplaire entre le gouvernement royal du Cambodge, et, à Paris, le musée national des Arts asiatiques – Guimet, l’École française d’Extrême-Orient et le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF).
UN « GÉANT D’AIRAIN » RESTAURÉ
Difficile de ne pas détourner son regard de l’imposante statue du dieu Vishnou illuminant de sa présence les salles de sculptures khmères, au rez-de-chaussée du musée parisien. En dépit de son état de conservation lacunaire, ce bronze colossal, mesurant plus de 2 mètres et pesant 505 kilogrammes, a fait le long voyage depuis le Musée national du Cambodge, à Phnom Penh (où il est habituellement conservé), jusqu’à Paris, où il a été étudié et analysé sous toutes ses formes au C2RMF, avant d’être restauré pendant plusieurs semaines au laboratoire Arc’Antique, à Nantes.
Le résultat est stupéfiant de beauté et justifie, à lui seul, le déplacement au musée Guimet pour se recueillir, tel un pèlerin, devant cette divinité coulée dans le bronze par ces artisans de génie qu’étaient les fondeurs d’Angkor, la capitale de l’Empire khmer (IXe-XVe siècle).
Découverte en décembre 1936 par l’archéologue français Maurice Glaize dans le puits central du temple du Mebon occidental, cette œuvre, datant du XIe siècle, représentait le dieu Vishnou allongé sur le cobra polycéphale Ananta (« celui qui est infini, éternel ou illimité ») et était à l’origine dotée de quatre bras, la tête reposant sur l’une de ses mains droites. Bénéficiant du concours d’une quarantaine de chercheurs – métallurgistes, géologues, chimistes, archéologues, restaurateurs et historiens d’art –, l’effigie divine a ainsi pu retrouver une part de sa splendeur grâce au remontage de certains de ses fragments et à la réalisation d’un socle que les autorités cambodgiennes souhaitent conserver après le réacheminement de la statue au Musée national du Cambodge.
On ne saurait trop conseiller au visiteur de prendre le temps de tourner autour de ce « géant d’airain » somptueusement paré, et dont le moindre détail est un petit miracle de préciosité. Il faut néanmoins imaginer l’aspect originel de cette statue de culte, dont la surface était entièrement dorée à l’amalgame de mercure, les sourcils, la moustache et la barbe incrustés d’un composé à base de plomb, le blanc des yeux et les plis du cou rehaussés d’argent, et les lèvres colorées de rouge par l’ajout de cinabre. Il n’est pas certain que ce Vishnou nous ait alors tant séduits !
LES APPORTS DE L’ARCHÉOLOGIE DE TERRAIN
Et c’est tout l’intérêt de cette exposition – qui s’appuie sur la récente découverte par l’École française d’Extrême-Orient d’une fonderie royale à Angkor Thom, et d’un vaste complexe minier et métallurgique dans la région de Chhaep, à 180 kilomètres au nord-est d’Angkor – que de redonner à l’art du bronze toute la place qu’il mérite au sein de cette civilisation dans laquelle le pouvoir était intimement lié au sacré. À travers 240 œuvres (dont 126 prêts consentis exceptionnellement par le Musée national du Cambodge), le visiteur découvre la virtuosité technique des artisans khmers dès les temps les plus anciens. Vers 1100-1000 avant notre ère, des communautés agricoles sédentarisées d’Asie du Sud-Est commencent à extraire du minerai du cuivre et à produire des petits objets utilitaires en bronze – obtenu à partir d’un alliage de cuivre et d’étain.

Thierry Zéphir, l’un des commissaires de l’exposition, devant la statue restaurée du Vishnou du Mebon occidental, au musée national des Arts asiatiques – Guimet, à Paris. Photo Bérénice Geoffroy-Schneiter
Parmi les pièces les plus fascinantes de l’exposition figure un récipient rituel, daté entre 400avant notre ère et 200 après notre ère, en forme de hotte de vannerie ou d’outre en peau, dont l’usage demeure encore énigmatique. S’agissait-il d’un instrument de percussion utilisé dans le cadre de cultes agraires destinés à favoriser la fertilité de la terre ? Alternant symboles terrestres (triangles, cerfs, paons) et symboles aquatiques (spirales, pirogues à rameurs, éléphants), son décor gravé pourrait accréditer cette hypothèse...
Fouillé en 2009 par une équipe d’archéologues allemands et cambodgiens, le cimetière de Prohear a livré, quant à lui, une quantité impressionnante d’offrandes funéraires, dont un tambour déformé et fragmentaire qui contenait le crâne d’une femme. Comparable en bien des points à d’autres exemplaires de la culture protohistorique Dong Song (de 2000 avant notre ère au Ier siècle), cet objet au symbolisme cosmique témoigne des échanges noués entre les différents peuples du sud de la Chine et du nord du Vietnam.
Mais c’est à l’apogée du royaume d’Angkor que l’art des bronziers khmers atteint des sommets de sophistication, afin de légitimer le pouvoir royal et les divinités qui lui sont attachées. Ayant miraculeusement échappé aux pillages – voire au cycle infernal des refontes ! –, des images de dévotion hindoues et bouddhiques en or, en argent, ou en bronze doré ornaient ainsi les cellae des temples, aux côtés de nombreux accessoires du rituel (lampes encensoirs, brûle-parfum, grelots, tambourins, conques…). L’une des œuvres les plus exquises de l’exposition est une figurine féminine agenouillée, qui supportait à l’origine un grand miroir en bronze fiché dans sa coiffure en chignon. Mais loin d’être seulement décoratif, cette gracieuse cariatide était indissociable de sa fonction cultuelle, le miroir étant perçu dans le monde indien et indianisé comme un symbole de la Vérité, l’image de la pure conscience et de la vacuité consubstantielle à toute chose dans l’univers.
Aussi raffinées et majestueuses soient-elles, ces sculptures de divinités coulées dans le bronze demeurent cependant, aux yeux des Cambodgiens, bien plus que de simples œuvres d’art. « Ce sont des images vivantes et incarnées, et les fidèles qui viennent dans les musées prient et se prosternent devant elles », souligne ainsi Thierry Zéphir, l’un des commissaires de l’exposition. C’est dire l’immense sacrifice qu’ont consenti les autorités du Cambodge en se séparant de ces sublimes déités pour les offrir à notre pure délectation.
-
« Bronzes royaux d’Angkor, un art du divin », 30 avril-8 septembre 2025, musée national des Arts asiatiques – Guimet, 6, place d’Iéna, 75016 Paris.