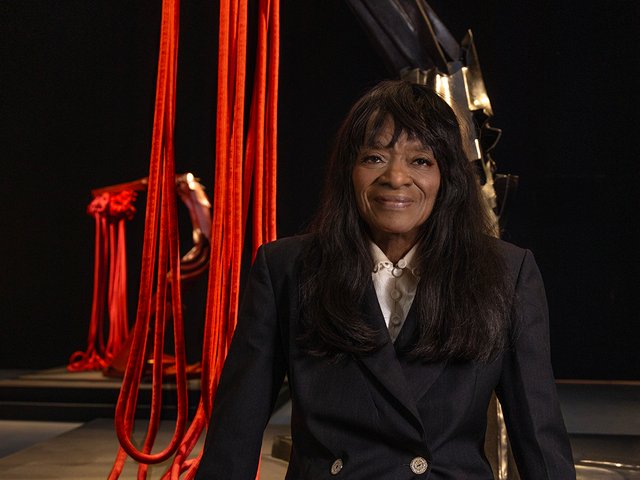Consacrer aux communautés panafricaines et transatlantiques réunies à Paris pendant la deuxième moitié du XXe siècle un vaste panorama d’œuvres de 150 artistes, alors même que le Centre Pompidou commence à fermer ses espaces parisiens pour plusieurs années de transformation : le choix est à l’évidence symbolique pour le musée national d’Art moderne qui s’y est installé en 1977 avec, pour rappel, les expositions « Marcel Duchamp » et « Paris-New York ». Déjà, à l’époque, il s’agissait de rattrapage (avec la première rétrospective d’envergure dévolue à l’inventeur du ready-made, près de quinze ans après celle de Pasadena, en Californie) et de circulations artistiques à l’échelle du monde.
Mais ce monde, indéniablement, a changé durant ces cinq dernières décennies, de même que les prismes à travers lesquels on observe et l’on aborde l’art aujourd’hui : la multiplication des centres et les problématiques postcoloniales, communautaires et identitaires remettent en question depuis longtemps la construction occidentalocentrée de la modernité.
L’exposition « Paris Noir. Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950-2000 » ajoute un nouveau chapitre à cette ouverture du regard et de la pensée – engagée, entre ces mêmes murs, avec « Magiciens de la terre » (1989), « Africa Remix » (2004) ou encore « Modernités plurielles » (2015) –, autant qu’elle fait le point sur le travail de terrain et de prospection mené par sa commissaire, Alicia Knock, et les équipes du service de la création contemporaine et prospective du musée (Eva Barois de Caevel, Aurélien Bernard, Laure Chauvelot et Marie Siguier). Ce sera peut-être l’un des axes des reconfigurations à venir pour l’institution, à l’instar de celles qui ont présidé à la muséographie mise en œuvre à la Tate Modern, à Londres, depuis l’ouverture du site en 2000.
Un cheminement rhizomatique
Foisonnante, l’exposition mêle des œuvres de toutes natures et tendances à de nombreux documents d’archives imprimés ou enregistrés, artistiques ou politiques ; elle croise destinées d’artistes et témoignages de vie, observations sociétales et prises de position politiques, s’appuyant sur les circuits par lesquels les artistes descendants africains et leurs œuvres ont été vus – ou non – à Paris : expositions, revues (de Présence africaine créée en 1947 par Alioune Diop à la Revue Noire publiée entre 1991 et 2000), lieux et passeurs, rassemblements et moments de prise de conscience, dont le premier congrès des écrivains et artistes noirs organisé à la Sorbonne en 1956.
La visite s’organise en un mouvement de rotation autour d’une évocation du « Tout-Monde » et du métissage théorisés par Édouard Glissant, où l’on repasse à plusieurs reprises, par différents points, comme s’il s’agissait d’un pôle magnétique et protéiforme capable de tout attirer et de tout recomposer. « J’écris en présence de toutes les langues du monde » et « Nous ne sauverons pas une langue, en laissant périr les autres », lit-on, sur une page de manuscrit, de part et d’autre d’une ligne enroulée en spirale.
Autour de ce point, le parcours se veut rhizomatique, scandé aussi par des échos et des figures récurrentes. Les sculptures du Cubain Augustín Cárdenas (1927-2001, mort à La Havane et enterré à Paris) accompagnent ainsi le public de leurs formes pleines et courbes. Elles résonnent autant de l’histoire des transformations de la sculpture moderne (de Constantin Brancusi à Jean Arp) que de celle des Caraïbes et de la fascination qu’elles ont suscitée chez les sur-réalistes. Et l’on est attiré, de loin en loin, par les taches lumineuses et homogènes que forment les peintures de Beauford Delaney (1901-1979), dont les dominantes jaunes, quels que soient le sujet et son degré d’effacement, témoignent de la constance des recherches de celui qui connut les derniers feux de la Harlem Renaissance et étudia avec Thomas Hart Benton – comme Jackson Pollock – avant de s’installer en France où sa manière postimpressionniste rencontra sa lumière, dans le voisinage de son compatriote, exilé lui aussi, l’écrivain James Baldwin.

Élodie Barthélemy, Hommage aux ancêtres marrons, 1994, laine, fer, bois et chevelures. © Élodie Barthélemy. Photo Pierre-Yves Page
« La prochaine fois, le feu » ?
Il est difficile, dans la durée d’une visite, de se familiariser avec tant d’artistes pour beaucoup méconnus, comme l’on doit se contenter de quelques minutes de ces films qui rythment le parcours et que l’on espère avoir l’occasion de voir ailleurs, par exemple La Noire de... d’Ousmane Sembène (1966). La singularité de chaque destin échappe quand elle n’est pas inscrite à même les œuvres. De même que le lien entre celles-ci et le combat anticolonial lorsqu’il n’est pas explicite, comme dans le diptyque Sans titre (1975) de José Legrand qui y représente, d’après une photographie parue dans la presse, les manifestations alertant alors sur la situation critique de sa Guyane natale.
Le propre d’une exposition étant de montrer des œuvres, les débats politiques qui en forment, à n’en pas douter, le contexte, voire le terreau, ne sont le plus souvent saisis que comme un arrière-fond. On s’aperçoit – et c’est aussi l’un des enseignements de l’exposition – que l’on ne se défait pas aisément du réflexe d’identification ou de comparaison, et que celui-ci sert plus qu’on ne le voudrait de boussole : on se repère en effet aux formes familières, occidentales ou non, qu’il s’agisse de moyens (le collage, l’assemblage, le tressage ou le tissage), de tendances (la figuration et l’abstraction) ou de références à des artistes connus.
Il faut sans doute plus de temps également pour apprécier toutes les nuances que recèlent les œuvres quant aux dynamiques de métissage, d’affirmation identitaire, d’acculturation et de voisinage dans lesquelles elles sont prises et qui, dans le cadre spécifique de la manifestation, doivent les inscrire dans ce Paris Noir annoncé par le titre. Que fait l’œuvre de Wifredo Lam à l’histoire du surréalisme au sein de laquelle elle est au demeurant intégrée ? Comment le collage, par essence hybride, affirme-t-il ses différences (chez Ted Joans par exemple) ? Qu’est-ce qui distingue, de visu, une abstraction d’Ed Clark (Sans titre [Vétheuil], 1968) d’une autre, contemporaine ? Et que produit le frottement entre formes traditionnelles et minimalistes dans les sculptures de Frantz Absalon ? On quitte l’exposition plus riche de toutes ces interrogations parmi bien d’autres encore, plus préparé aux prochaines rencontres avec les artistes et les œuvres qu’elle donne à voir, la curiosité attisée pour certains et certaines d’entre eux, et décidément plus à l’écoute des nouvelles dynamiques de pensée qui émergeront sur la base de cette ample mise au jour d’une histoire absolument incontournable.
-
« Paris noir. Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950-2000 », 19 mars-30 juin 2025, Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, 75004 Paris, centrepompidou.fr