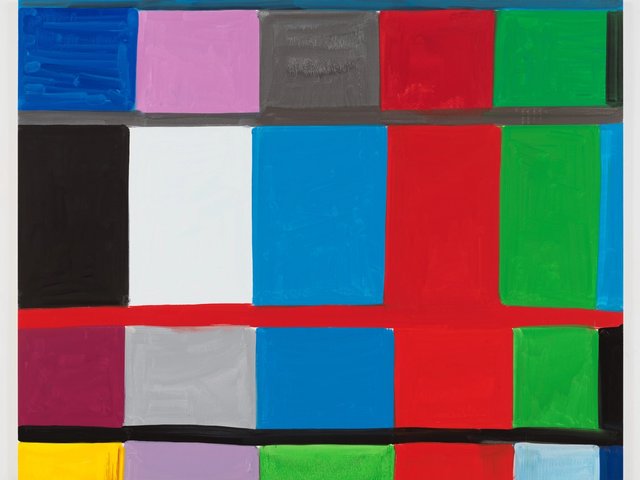Lorraine O’Grady
Depuis la rétrospective que lui a consacrée le Brooklyn Museum en 2021, on mesure à quel point Lorraine O’Grady (1934-2024) a pu être en avance sur son époque, dans son affirmation d’un point de vue féministe noir et son refus du binarisme. Bostonienne d’un milieu privilégié avec des racines jamaïcaines, elle déclarait dans une interview : « Je pratique des incisions dans la culture et je mets autant de moi-même dans chaque incision afin que personne ne pense que je ne fais qu’un genre de choses ou que je ne suis qu’une personne ». L’exposition retrace l’ensemble de son parcours à travers des photographies de quatre grandes séries.
C’est en 1980 que Lorraine O’Grady a fait irruption dans le monde de l’art en s’invitant, en deux occasions dans des espaces d’art indépendants, en tant que Melle Bourgeoise noire, le nom écrit sur son écharpe. Coiffée d’une tiare, vêtue d’une robe faite d’un assemblage de gants blancs, avec en main un chat à neuf queues terminées par des chrysanthèmes, elle concluait ses apparitions par une déclaration et une autoflagellation. En un temps où les artistes noires étaient invisibles et où le féminisme ignorait la question raciale, ces performances agissaient comme un révélateur.
Mais l’œuvre centrale de l’exposition, ce sont les 48 photos qui documentent Rivers first Draft (1982). Lors de cette performance sauvage, organisée en différents points de Central Park, Lorraine O’Grady racontait une part de son histoire. Les photos ont superbement capturé un événement qui semble tenir du happening et de la fête pour enfants. Dans la série des photomontages en noir et blanc intitulée Body is the Ground of My Experience, elle laisse apparaître l’influence revendiquée du surréalisme. The Fir-Palm, inspiré d’un poème de Heinrich Heine, montre un croisement de palmier et de sapin qui sort du nombril d’une femme noire. Enfin, dans la série Announcement of A New Persona (2020), elle met en scène un nouvel avatar d’elle-même, en armure coiffée d’un palmier, pour un ultime combat.
Du 3 avril au 31 mai 202, Mariane Ibrahim, 18 avenue Matignon, 75008 Paris

Vue de l’exposition « Amine Habki & Silina Syan : Noor Reflections » à la Galerie Eric Mouchet, Paris. Photo © Hafid Lhachmi
Amine Habki & Silina Syan : Noor Reflections
Amine Habki a choisi le crochet et la broderie comme médium en s’inspirant aussi bien de la peinture de la Renaissance que des arts traditionnels de l’islam pour réformer l’image imposée de la masculinité. À une moitié de buste d’homme en laine bouclée, il associe une autre moitié peinte sur un marcel suspendu à une corde à linge, fait d’un torse musclé un motif de tapis ou lie par un fil un visage à un coussin à épingles. Dans ces compositions qui tiennent pour partie du collage se rejoignent la peinture du quotidien, l’image de saints en extase et le conte oriental. Le vêtement suspendu, le rideau sur une tringle ou le canevas de tapisserie bariolé de couleurs s’offrent comme autant d’équivalents triviaux du tableau. Amine Habki pratique la déconstruction et la réécriture du discours dominant avec gaieté et sensualité.
De la culture bangladeshie, qui constitue une part de son héritage, Silina Syan a fait un sujet d’enquête et une source d’inspiration pour ses œuvres. Sur un rideau de boucher à lamelles, elle a fait imprimer les photos d’un rayon de bazar où les emballages de savons ou de shampooings multiplient visages et motifs floraux dans des tons sucrés ; ou bien, dans une vitrine verticale de boutique, elle expose l’annonce pour la vente d’un mobilier de chambre à coucher à prix sacrifié. Les techniques de la Pictures Generation sont entraînées vers l’exotisme, et détournées au profit d’une approche plus empathique que critique. Plus qu’à s’approprier la pacotille au nom de l’art, Silina Syan met en évidence la proximité entre différents espaces d’exposition. Le rideau de chaînes et de médaillons avec portraits de femmes bangladeshies qui ouvre l’exposition revêt à cet égard un caractère symbolique. Le point de convergence entre l’univers de Silina Syan et celui d’Amine Habki serait, selon le texte de présentation, « une certaine idée de transparence traversée de lumière. »
Du 19 avril au 24 mai 2025, Galerie Eric Mouchet, 45, rue Jacob, 75006 Paris

Vue de l’exposition « Jamiu Agboke : Don’t Go Chasing Waterfalls » chez MASSIMODECARLO Pièce Unique. Courtesy de l’artiste et MASSIMODECARLO
Jamiu Agboke : Don’t Go Chasing Waterfalls
Deux tableaux de Jamiu Agboke sont présentés en alternance dans la vitrine de Pièce Unique. Ils ont en commun de représenter chacun une chute d’eau et d’être peints sur une surface d’aluminium encadrée par une fine baguette de bois. Le choix par l’artiste de renoncer à la toile pour l’aluminium (ou pour le cuivre, dans d’autres de ses œuvres) a eu des incidences importantes pour son travail. Jamiu Agboke ne s’autorise aucune correction et tire profit de la luminosité du support qu’il laisse voir en certains endroits. Don’t Go Chasing Waterfalls, qui donne son titre à l’exposition, est un format vertical nourri de William Turner et de peinture chinoise, qui restitue une vision en mouvement du paysage, en variant et en multipliant les effets. L’artiste mêle souvenirs et inventions, mais montre aussi le travail de la peinture par quelques gestes qui paraissent affranchis de tout mimétisme. Peekaboo est un tableau horizontal construit sur une masse de blanc, de gris et de bleu, encadrée par une sorte de cuvette noire. Cette masse d’eau, énergie et lumière pures, a une présence presque palpable, tandis que la cuvette est peinte d’un pinceau fluide qui évoque la plaque de gravure non encore nettoyée de son encre. Ce mélange d’affirmation et d’effacement, cette rencontre du sublime et de la réalité de l’atelier, sont proprement électrisants.
Du 13 mai au 24 mai 2025, MASSIMODECARLO Pièce Unique, 57, rue de Turenne, 75003 Paris

Vue de l’exposition « Mimmo Haraditiohadi : Zu neuen Ufern » chez Petrine, Paris. Courtesy the artist and Petrine, Paris & Düsseldorf. Photo Thomas Lannes
Mimmo Haraditiohadi : Zu neuen Ufern
« Zu neuen Ufern » : sous ce titre mystérieux et teinté d’humour, Mimmo Haraditiohadi expose six tableaux répartis dans les espaces de la galerie. Ces toiles semblent fonctionner par paires, soit trois motifs ou compositions répétés avec des variations de teinte. Deux moyens formats peints en aplats, l’un en vert et blanc, l’autre en bleu, blanc et rouge, montrent un paquebot dressé à la verticale. Cette position de la silhouette à trois cheminées et la présence d’un point dans l’espace négatif à droite font voir une figure. Ce sont aussi bien des images doubles que des compositions géométriques dans l’esprit des avant-gardes historiques. Mimmo Haraditiohadi s’est souvent servi du motif du paquebot pour recouvrir un tableau raté, et s’en sert aujourd’hui pour son caractère symbolique et poétique. Les quatre autres tableaux sont, eux, de petit format. Deux d’entre eux montrent le bas de la gueule de Cornelius, héros de La Planète des Singes, les deux autres le bas de la gueule de Chewbacca de Star Wars. Ces œuvres sont réalisées dans une matière un peu épaisse, de véritables morceaux de peinture. Ce cadrage produit un effet de caméra subjective qui nous projette dans l’espace de la fiction. Le choix des références, la répétition, l’opposition entre deux types de figuration offrent autant une ouverture sur des imaginaires qu’un espace de réflexion sur la peinture et ses langages.
Du 10 mai au 28 juin 2025, Petrine, 29 rue des Petites Écuries, 75010 Paris